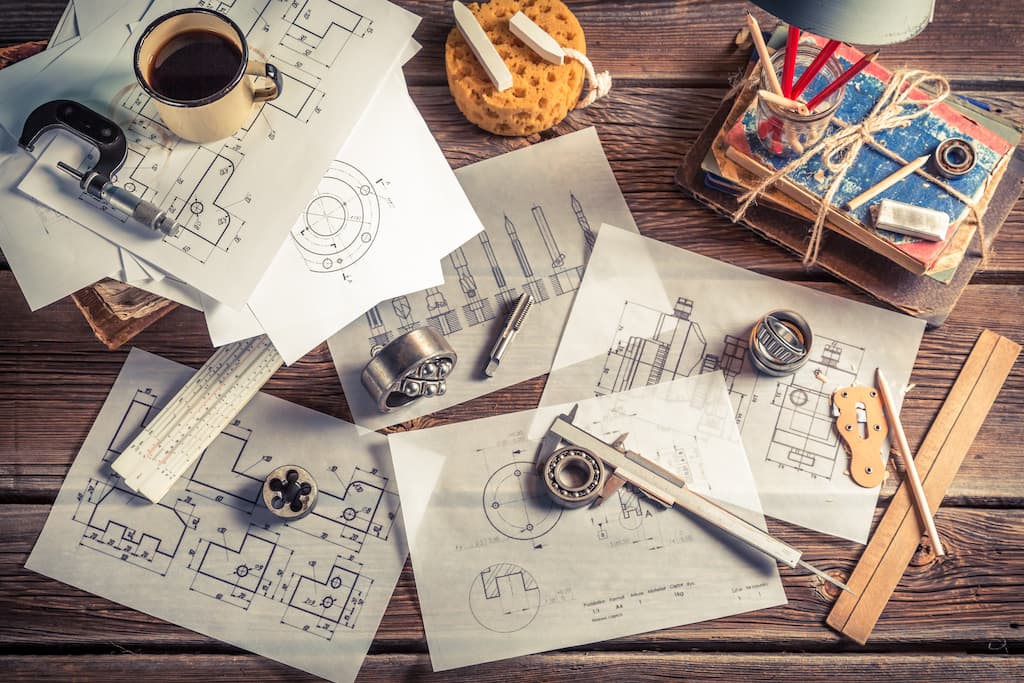L’abandon et l’annulation d’un brevet constituent deux mécanismes distincts qui entraînent la perte des droits exclusifs du titulaire, mais selon des modalités et des conséquences juridiques différentes. Ces situations soulèvent des questions complexes quant à leurs effets sur les tiers et les relations contractuelles préexistantes.
Les différences fondamentales entre abandon et annulation
L’abandon de brevet résulte d’une décision volontaire du titulaire qui peut renoncer à la totalité du brevet ou à une ou plusieurs revendications. Cette procédure permet au propriétaire d’éviter une procédure en nullité longue et coûteuse ou de donner suite à un accord amiable. La renonciation est une procédure permettant d’annuler son propre brevet : rétroactivement.
L’annulation, en revanche, est prononcée par une décision de justice. L’article L613-27 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la décision d’annulation d’un brevet d’invention a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition ». Il résulte des termes du code qu’une annulation de brevet a des effets absolus, c’est-à-dire un anéantissement de tous les droits qu’il ouvrait jusque-là.
Les effets immédiats sur les droits du titulaire
Dans les deux cas, les conséquences sont drastiques pour l’ancien titulaire. Le titulaire du brevet perd les droits exclusifs qu’il détenait. Il ne peut plus empêcher des tiers d’exploiter l’invention qui était protégée par le brevet annulé.
Il est acquis, dans la jurisprudence comme dans la doctrine, que le caractère absolu de cette annulation joue pour les effets que le brevet aurait normalement produits si la protection avait été maintenue. Il ne sera donc plus possible pour l’ancien titulaire de vendre des licences par exemple ou encore de se protéger contre la diffusion des techniques préalablement brevetées.
L’impact sur les actions en contrefaçon
L’une des conséquences les plus importantes concerne le sort des actions en contrefaçon. Toute action en contrefaçon basée sur ce brevet devient caduque avec effet rétroactif. Les procédures en cours sont abandonnées et les décisions déjà rendues peuvent être remises en question.
Cependant, la jurisprudence française a apporté des nuances importantes concernant les décisions définitives. La Cour de cassation, dans sa décision du 17 février 2012 rendue sur avis conforme du premier avocat général, rejette le pourvoi au motif « qu’ayant relevé que M. X avait été condamné comme contrefacteur par une décision irrévocable, la cour d’appel en a exactement déduit que l’anéantissement rétroactif et absolu du brevet dans la mesure de l’annulation des revendications prononcée par une décision postérieure n’était pas de nature à fonder la restitution des sommes ».
Cette solution jurisprudentielle s’explique par la nécessité de préserver l’autorité de la chose jugée. En l’espèce, M. X a été condamné au paiement de diverses sommes par un arrêt irrévocable du 10 septembre 2001 pour contrefaçon par reproduction des revendications 1, 3, 4 et 5 du brevet, enregistré sous le numéro 87-03865. Ces revendications ayant été annulées par un arrêt du 21 février 2002, irrévocable, M. X a assigné M. Y et la société exploitante en restitution de ces sommes.
Les conséquences sur les contrats de licence et de cession
Impact sur les contrats existants
En application des articles L.613-27 du Code de la propriété intellectuelle et 138 de la Convention sur le brevet européen, la nullité du brevet contesté a un effet absolu et rétroactif, et le titre est anéanti à la date du dépôt. Dès lors, la nullité du brevet est censée entrainer la nullité des contrats de licence et les priver de tout effet.
Les conséquences juridiques et financières pour les contrats de licence ou de cession sont à apprécier au regard des dispositions contractuelles. Dans certains cas, des restitutions de redevances peuvent être demandées.
La question des redevances
La jurisprudence est elle-même hésitante : alors qu’elle a pu rejeter la restitution de redevances versées pour une licence sur un brevet annulé par la suite dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 28 janvier 2003, elle a ensuite considéré qu’à l’inverse une procédure en indemnisation d’un préjudice fondée sur un brevet annulé ensuite se trouve privée de tout fondement juridique.
La Cour de cassation avait ainsi tranché en considérant que si la licence devait être annulée, les redevances payées ne devait pas être remboursées au motif que le licencié avait bénéficié de la protection accordée par le brevet pour toute la période durant celui-ci avait été tenu pour valide. Si le concédant était en mesure de restituer les redevances perçues, le licencié n’était pas en mesure de restituer la protection que le brevet lui avait apportée.
Un cas pratique illustre cette approche : Les rémunérations mises à la charge du licencié n’étant pas dépourvue de cause, le licencié ne peut réclamer son remboursement. De plus, le contrat contient une clause de garantie qui stipule « au cas où le brevet viendrait à être déclaré nul par décision de justice définitive, (…) le licencié ne pourra prétendre à aucune indemnité compensatrice, ni au remboursement des redevances… ». La cour confirme la validité de cette clause et déboute la société de sa demande en remboursement.
Les formalités administratives obligatoires
D’un point de vue pratique, la disposition est la suite logique de l’annulation : il convient, pour qu’elle soit effective, que l’institution qui est en charge de l’enregistrement des dépôts puisse mettre à jour ses données afin qu’un brevet annulé ne soit plus connu par elle comme étant protégé. Le caractère absolu de l’annulation commande une modification des données de l’INPI.
Pour l’abandon volontaire, si la demande est régulière, vous recevez un exemplaire de votre demande comportant un numéro et la date d’inscription au Registre national des brevets. Environ 4 à 6 semaines après l’inscription au registre, l’inscription est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) afin de la rendre publique.
L’enjeu de la sécurité juridique
Les effets d’une annulation rétroactive absolue seraient lourds en conséquence, d’autant plus que la protection court pour une durée de 20 ans, ce qui impose de tenir compte de la sécurité juridique.
En revanche, le principe de sécurité juridique, même s’il n’est pas consacré comme tel dans l’ordre judiciaire, commande que ce caractère absolu puisse être aménagé pour ce qui concerne les effets du brevet déjà réalisés. Ainsi, l’annulation absolue pour l’avenir fait face aujourd’hui à une exigence de sécurité juridique non négligeable.
Les modalités pratiques de l’abandon volontaire
Un brevet est un bien immatériel dont vous pouvez disposer selon vos intérêts ou vos besoins. Vous pouvez ainsi y renoncer en partie ou en totalité. Le brevet doit être délivré pour faire l’objet d’une renonciation.
Cela veut dire qu’une personne qui a droit au monopole d’exploitation sur une invention décide délibérément, de son propre chef, d’abandonner ce monopole qu’elle possède sur tout ou une partie de l’invention en question. Renoncer à son brevet est aussi un moyen d’éviter une procédure en nullité.
Le prix de la démarche pour renoncer à un brevet dépend du type de procédure. Ainsi, en 2020, le prix pour renoncer à un brevet grâce à une procédure classique est de 27 euros. Par contre, si on veut accélérer la procédure, il faudra payer 52 euros en plus. Quant à la taxe pour limiter un brevet, elle est en 2020 de 260 euros.
Les implications pratiques pour les entreprises
L’abandon ou l’annulation d’un brevet crée une situation paradoxale : d’un côté, l’invention tombe immédiatement dans le domaine public, permettant à tous de l’exploiter librement ; de l’autre, certains effets passés du brevet peuvent subsister par souci de sécurité juridique. Cette dualité oblige les entreprises à une vigilance particulière dans la rédaction de leurs contrats de licence, notamment par l’insertion de clauses de garantie appropriées, et dans le suivi de la validité des brevets sur lesquels elles fondent leur stratégie commerciale.
La Cour de cassation française (Assemblée plénière) clarifie sa jurisprudence : « l’anéantissement rétroactif et absolu du brevet (…) n’est pas de nature à fonder la restitution des sommes payées en exécution d’une condamnation du chef de contrefaçon. » Cela peut paraitre sévère mais la sécurité juridique est à ce prix.